« (…) la loi de nature : par cette loi, qui est commune à tous les hommes, chacun forme avec le reste du genre humain une communauté (…) qui les distingue de toutes les autres créatures. »
Locke, Second Traité du Gouvernement
Bien vaine serait cette lecture suspicieuse, qui chercherait dans cet article le vouloir-dire d’un Locke que je ne connais que trop mal. Je ne saurais rien dire de la base théologique des deux Traités, mais je reste tout autant coi devant la nécessité pour Locke de justifier son système en excluant cette même assise religieuse. Et si les deux Traités du Gouvernement s’inséreraient en effet bien entre la Genèse et l’Exode, il n’en reste pas moins que Locke a bien été obligé de faire autrement. De même, l’ouvrage de Macpherson est convaincant. Indiscutablement — dans le sens que je ne veux pas en discuter. Non ce qui m’intéresse est la dimension morale obligée du libéralisme lockien, cette obligation au cœur du jugement moral qui peut nous permettre de faire jouer Locke contre lui-même.
Si l’on y décèle bien chez Locke une pensée de la communauté comme totalité, jamais cette totalité n’engage de décision philosophique. Locke ne pense pas depuis le tout, il s’intéresse presque exclusivement aux médiations par lesquelles l’homme, à la différences des autres créatures, peut accéder à la communauté, mais c’est une chose étrange qu’à l’inverse on ait détecté chez lui quelque individualisme, puisque son point de départ n’est pas le sujet, pas davantage que la communauté (qui est une autre médiation), mais un genre d’intersubjectivité — notion que nous devons maintenant éclaircir pour échapper à un nouvel anachronisme.
Il est exact que Locke s’appuie sur l’état de nature pour affirmer l’existence d’un droit individuel revendiqué avec force, mais ce droit n’est toujours convoqué que pour justifier de l’association des hommes entre eux : il ne vaut jamais pour lui-même. Par exemple, le droit de nature fondamental que chacun possède est de venir en aide à celui qui est violenté par autrui.
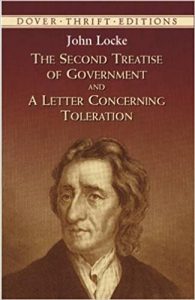 Or, ce droit, paradoxal, de tuer pour la préservation de la vie, et qui n’est paradoxal qu’oublié qu’il est la traduction d’un projet divin pour l’homme, est directement analogue, y compris dans son apparence contradictoire, au droit d’appropriation, qui n’existe chez Locke qu’en tant qu’il crée, par le truchement du travail, un excédent de biens dont la signification primordiale est d’accorder à autrui un droit sur cet excédent. Le mouvement naturel de la propriété n’est pas l’extension ou l’accumulation, mais le partage.
Or, ce droit, paradoxal, de tuer pour la préservation de la vie, et qui n’est paradoxal qu’oublié qu’il est la traduction d’un projet divin pour l’homme, est directement analogue, y compris dans son apparence contradictoire, au droit d’appropriation, qui n’existe chez Locke qu’en tant qu’il crée, par le truchement du travail, un excédent de biens dont la signification primordiale est d’accorder à autrui un droit sur cet excédent. Le mouvement naturel de la propriété n’est pas l’extension ou l’accumulation, mais le partage.
Si nous prenons l’usage de la monnaie, qui semble à première vue problématique à Locke, il apparaît bien vite qu’elle n’est un handicap qu’aussi longtemps que ne lui est pas appliqué et comme imposé la loi naturelle : une fois celle-ci admise au sein de la société civile, la monnaie accélère le partage en augmentant la quantité de biens disponibles. Le véritable problème soulevé par Locke est donc l’écart, le décalage dans l’application de la loi de nature au sein des sociétés civiles, auquel il faut remédier. Ce point de sa philosophie peut être aussi révolutionnaire que sa défense de la désobéissance civile. Mais Locke, il est vrai, est sans doute passé promptement à côté…
Le paragraphe 45 du chapitre De la propriété montre pourtant, par l’exemple des États, que ceux-ci, à l’intérieur de leur territoire ont naturellement interprété le travail comme un droit à la propriété, mais dans le même temps ont, dans leurs relations internationales, admis la nécessité du renoncement à l’extension illimitée des territoires nationaux. C’est la même logique qui conduit Locke à réduire la part de chaque citoyen et en faire leur propriété irrévocable. Ces parts ne deviennent d’ailleurs irrévocables que parce qu’elles sont ramenées par le travail à leur juste proportion, ou plutôt sont-elles ramenées à de plus justes proportions pour les fonder en irrévocabilité, donc en propriété. La propriété foncière suit ici le même processus, le même traitement que les pouvoirs individuels, largement ramenés en-deçà de leur extension maximale quand ils deviennent droits civiles. C’est pour cela encore que Locke dit bien que l’usage de la monnaie est conforme à la loi de nature quand elle rend imputrescibles les fruits du travail, mais il ne le dit pas sans faire savoir que la loi de nature est violée par l’appropriation infinie permise par la monnaie quand n’est pas permis le partage infini.
Mais voilà : cette appropriation infinie a reçu le consentement de la majorité, et Locke n’a de cesse de répéter que le consentement du peuple est le fondement de la légitimité des gouvernement. La base morale de l’appropriation infinie n’est-elle alors pas garantie par cela ?
Locke le dit bien : cette extension infinie non assortie de partage infini a été instauré « en dehors des liens de la société et sans contrat. » Le partage des terres sans contrat est possible mais illégitime puisqu’il s’effectue en dehors des lois. Il semble donc bien que Locke soit fondé à infirmer sans plus attendre l’extension infinie de la propriété… idée qu’il ne formule cependant pas, le texte s’arrêtant brusquement là pour s’intéresser dans un nouveau chapitre d’allure interpolé et donc quelque peu interlope, au pouvoir paternel… Peut-on alors prendre pour argent comptant l’implicite d’un découlement logique ?
Il faut alors faire deux remarques : d’une part, Locke a déjà signalé que le peuple pouvait consentir à des mesures irrationnelles, ce qui sous-entend que son consentement doit être corrigé quand il le faut. D’autre part, la loi, « dans son acception véritable, la loi ne consiste pas tant à limiter un agent libre et intelligent qu’à le guider vers ses propres intérêts. » Il semble ainsi clair que si Locke s’intéresse maintenant et sans continuité apparente à la paternité et la forme de pouvoir qu’elle suggère, c’est qu’il est conduit par la logique même de son raisonnement à prolonger cette question de la propriété sous l’empire de la monnaie par celle de la nécessaire association des hommes, un thème qu’il avait d’ailleurs laissé en suspens. Or, l’association des hommes est l’échappatoire leur permettant de se soustraire à la violence d’autrui, et qui est l’autre nom de la liberté. C’est donc l’articulation de la liberté et de la propriété foncière qui est interrogée à la charnière de ces deux chapitres.
Car si Locke ne peut encore nommer violence l’appropriation infinie (il ne possède pas le matériel conceptuel pour cela), il en constate les effets délétères quant à la liberté. Voilà la relation établie. C’est pour cela que Locke ne cesse de répéter que le droit de propriété est d’abord une délimitation. Le droit de propriété est une loi, et en tant que tel il est un devoir bien avant que d’être un droit. Il n’y a donc pas de liberté de l’appropriation infinie, mais une liberté comprise comme propriété. La clôture dont on entoure une parcelle pour se l’approprier est d’abord une limitation pour soi-même. C’est un cadre. Le consentement populaire n’a ainsi pas le pouvoir de défaire cette loi qui vient avant toute convention. C’est pour cela que Locke en vient à l’autorité paternelle, pour rappeler que certaines pratiques légales, ainsi l’appropriation infinie, n’ont de légitimité que la coutume, la même qui a fait de pères des princes, c’est-à-dire une légitimité nulle au regard de Dieu. L’appropriation infinie viole la loi de nature sur le droit infini à la propriété en ce qu’elle exproprie l’homme d’un autre de ses biens : la liberté. Mais est-ce par ailleurs suffisant pour disqualifier le consentement ?
Il se trouve que c’est une fois la question de la généalogie de la légitimité politique réglée, que Locke revient à la société civile où, via l’opposition vive et réitérée entre l’homme capable de solidarité et les animaux isolés, est réaffirmé un devoir premier pour l’homme : accorder des droits à autrui. Cela est tellement vrai que refuser ses droits à autrui conduit encore à lui conférer un droit, puisqu’il est permis de tuer celui-là qui vous dénie des droits… Ce point corrobore directement l’idée que le « droit sur le corps de l’autre », qui implique « l’assistance mutuelle », veut que ce soit cette assistance mutuelle qui fonde le droit, et seulement elle. C’est à cette condition que le consentement devient cause nécessaire et suffisante. L’appropriation infinie était donc un tel exemple de consentement comme condition nécessaire mais non suffisante, et rien de plus que cela.
Cette logique est tout spécialement mise à profit, et sans doute de manière beaucoup plus limpide, dans le geste inaugural de constitution de la communauté, qui ne doit pas être un consentement de la majorité mais un « consentement de chaque individu. » Alors seulement et ensuite, la majorité devient motrice pour l’ensemble des individus du corps social. Car à tirer toutes les conséquences de ce raisonnement, il semble admissible que l’appropriation infinie est dans ce cadre un motif de dissolution de la communauté entière… Pour le dire avec d’autres mots et davantage de tiédeur, jamais Locke ne prétendrait que le prolétaire ou l’opprimé doive se plier à la l’appropriation infinie — qu’importe son consentement, — mais plutôt que le grand propriétaire doit partager car c’est à cela que la communauté doit consentir, majoritairement, et que « se soumettre aux lois d’un pays, y vivre tranquillement et jouir des privilèges et de la protection que ses lois confèrent, ne suffit pas pour devenir membre de cette société. » Cela veut dire que la délimitation de la propriété effectue un double mouvement complémentaire, que l’on saisit plus facilement quand Locke en vient à parler des lois fédérales, à savoir le droit international, et qui est encore un état de nature : la communauté qui s’est constituée circonscrit un territoire qu’elle ne partage avec aucune autre communauté… afin de rendre possible le partage au sein de ce territoire. Ce que la délimitation délimite est en premier lieu l’espace des limitations, dont la première est l’abandon des pouvoirs individuels à la communauté.
Bien sûr, ces pouvoirs dont se dote la communauté sont moins tournés vers l’intérieur que contre l’extérieur (il s’agit justement d’empêcher l’état de nature de pénétrer l’enceinte de la société civile), mais dans le fond : pourquoi ? Quel est ce péril qu’on ne souligne jamais chez Locke et qui semble donner l’envoi d’une communauté heureuse ?
Le Second Traité lui consacre pourtant une place d’importance : il s’agit d’une « incertitude », celle que ferait planer l’état de nature sur la communauté toute entière, et qui est la menace pour chacun de perdre sa propriété sans son consentement. Mais si Locke insiste tant sur cette idée, c’est qu’elle contient selon lui un paralogisme : la menace pour chacun de perdre sa propriété sans son consentement ne se résout pas par l’obtention du consentement général à la propriété, mais par la généralisation de cette angoisse, car cette incertitude que se propose de combattre la société civile ne peut être convertie en certitude si cette angoisse n’est pas, rien qu’un peu, partagée par tous…
Il faut alors que « que le peuple ait quelque propriété ».
